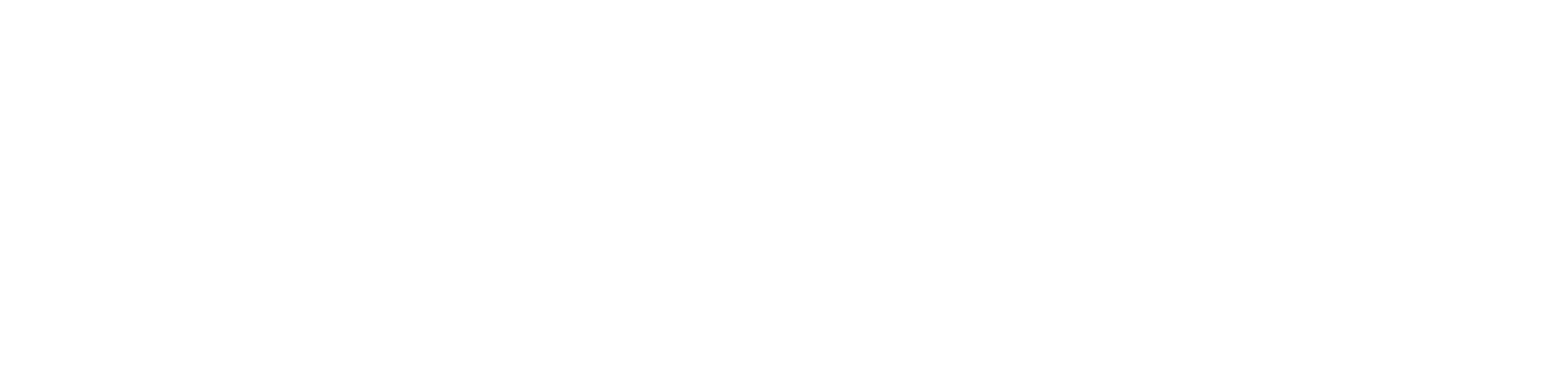SMART CITY
Urbanisation croissante, défis environnementaux, territoires fragmentés, crise sociale, évolution des modes de vie, attractivité économique et résidentielle, enjeux de gouvernance, complexité du projet urbain et de son jeu d’acteurs : autant de défis que les villes doivent aujourd’hui relever.
Face à cette réalité urbaine plurielle, il importe de trouver des moyens adaptés de concevoir la ville et le développement territorial. Une meilleure prise en compte des usages, la création de réelles modalités de concertation deviennent prioritaires. Les nouveaux processus à imaginer se doivent ainsi de répondre à un enjeu majeur : refonder des lieux urbains à vivre et inventer une ville créative et durable, recentrée sur le citoyen. Cela touche à la fois les infrastructures et les mobiliers urbains, les modes et moyens de transport et les différents services au sein de la ville.

La ville du futur, une ville intelligente ?
Un concept de Smart City
Poussé par la révolution numérique, le concept de « Smart City » fait son apparition dès les années 1980, au sein des mégapoles asiatiques, pionnières des technologies avancées (OpenDataSoft, 2016). Le gouvernement de la Corée du Sud est le premier à concevoir une stratégie avec pour socle l’omniprésence de l’informatique dans la ville.
En Occident, le terme de « Smart City » a été officiellement employé pour la première fois en 2005 par Bill Clinton lors d’un défi lancé par sa fondation à l’entreprise américaine Cisco. Un défi qui avait pour but de réduire le taux d’émissions de CO2 de villes telles qu’Amsterdam ou encore San Francisco. La firme IBM se trouve à la base de ce concept de Smart City, résultant d’une réflexion de reconquête du marché dans une période de récession. En effet, les villes représentaient un immense marché potentiel, en associant celles-ci aux technologies de l’information et de la communication. IBM diffuse ce terme auprès des villes, jusqu’à devenir un « urban labelling » (Albino et al., 2015). L’adjectif « smart » relève d’un choix marketing, plus convivial, et englobe une intelligence capable de s’adapter aux besoins des humains. La traduction française, qui porte à débat, nous amène au terme de ville intelligente. Si « smart » renvoie à l’adaptabilité, l’intelligence évoque quant à elle l’efficacité.
Cette notion émerge au fil du temps et est aujourd’hui le modèle de villes vers lesquelles se diriger, à adopter. En s’appuyant sur les T.I.C., une ville intelligente permettrait d’aménager des infrastructures adaptables, durables et qui communiquent entre elles, de manière automatisée. Avec en ligne de mire la gestion des transports et la consommation d’énergie, elle se présente comme la solution idéale pour améliorer la qualité de vie des citoyens, dans le respect de l’environnement.
Comment l’ère numérique peut-elle modifier à bien la structure de villes durables afin de répondre aux enjeux actuels ?
Les enjeux : la ville écologique
— Ville biologique et sociale
”« L’urgence d’un système biologique n‘est pas d’obtenir un résultat mais d’organiser pour lui des chances d’existence. D’un point de vue biologique exister correspond à une performance. La durée de la performance est la durée de vie de chaque être. La durée de vie de chaque être est tributaire du système dans lequel il se trouve mais aussi de sa configuration propre. »
Gilles Clément
La ville est un écosystème complexe et inachevé, suffisamment indéterminé pour pouvoir se réinventer en permanence. Nous sommes dans une phase de stagnation au niveau économique et au niveau architectural. Aujourd’hui, la nouvelle phase d’avant-garde possible est intimement liée à la question sociale et à la capacité d’un urbanisme d’intégrer en temps réel les transformations sociales, les pratiques émergentes et les changements de mentalités. Cela impliquerait aussi la mise en place de différents types d’architecture, d’une organisation différente et d’une répartition matérielle de l’espace urbain selon une mise en œuvre des conditions de partage du bien commun : paysages, ressources, énergies, espaces publics et collectifs….
L’avant-garde des mouvements sociaux va remodeler nos villes et nos bâtiments et cela va constituer un véritable défi parce que personne dans le monde de l’architecture n’est véritablement prêt pour cela. D’autant que les changements sociaux mutent beaucoup plus vite que le temps de l’urbanisme qui œuvre sur et pour le temps d’une génération.
— La ville doit être une source de solutions
Tout dans la ville devrait être mis à contribution. En plus de sa fonction primaire, chaque élément urbain devrait œuvrer en faveur de l’environnement et porter une attention aux incidences positives qu’elle peut générer sur son environnement dont elle tire et tirera profit et ainsi produire une plus-value globale. Cette production de valeur collatérale (matérielle ou immatérielle) est désormais un préalable à la durabilité urbaine (ou paysagère) pour renforcer à la fois son attractivité donc son intérêt collectif et son autonomie (pour évoluer, produire, et survivre).
Nous devons coupler le savoir biologique et le savoir architectural dans un rapport d’échanges, d’adaptabilité, d’évolutivité, et de production de valeurs (valeur économique, productive, énergétique, ou programmatique). La ville est alors comme un être organique, vivant, cyclique. L’écologie est non seulement le respect de notre planète, mais s’établit aussi dans la construction des rapports et des échanges entre les hommes. L’écologie construit l’économie circulaire, une gérance participative, une collaboration équitable, des relations où tout le monde est gagnant.
Les enjeux : la ville agile
— Ville malléable et adaptable : vers un urbanisme temporaire et temporel
La capacité d’un milieu urbain complexe à survivre, c’est son hétéronomie, son extraordinaire variabilité, qui lui permet d’adopter des stratégies de résilience. Les mutations sociales nous invitent à développer les outils d’un urbanisme des temps et à réfléchir autour de la figure stimulante de la « ville malléable », de la polyvalence et de la modularité des espaces et des bâtiments selon les moments de la journée, de la semaine ou de l’année. L’individu devient de plus en plus mobile. Il est poly-topique : il a plusieurs lieux. Il est poly-actifs : il a un portefeuille d’activités plutôt qu’un seul métier. Il fait preuve d’une constante instabilité : en famille, au travail, dans ses localisations. Il est hybride et imprévisible alors que l’offre urbaine reste relativement statique et rigide.
La tendance est à l’hybridation de pratiques, des temps et des espaces et aux nouveaux assemblages, alliances et collaborations : co-construction, co-développement, co-habitation, co-voiturage ou co-conception. Les frontières entre les temps et espaces de travail et de loisirs s’effacent. Des « Tiers-Lieux » émergent, qui mélangent plusieurs activités : cafés-bibliothèques, laveries-cafés, pépinières entrepreneurs-artistes, crèches installées dans les gares transformées en supermarchés, mais aussi toitures-jardins ou écomusées-lotissement. Face à l’éclatement des espaces, des temps et des mobilités, on assiste à l’émergence d’organisations spatio-temporelles où les notions de polychronie et d’intermittence sont essentielles.
Les bâtiments doivent faire preuve d’une certaine souplesse d’usage. Ils sont destinés à accueillir les différents types d’activité afin d’optimiser les déplacements et de concentrer un maximum d’offres possibles selon la période qui les justifie. La chronotopie des bâtiments et le polissage des sites deviennent dès lors la clé d’un espace public concentré et animé, et le moyen d’une minimisation des déplacements nuisants, depuis les lieux d’habitation d’où ils émanent principalement. C’est davantage sur la régulation et la gestion de la contiguïté de ses espaces, sur l’adaptabilité permanente de la ville à ses propres évolutions que l’urbain de demain doit pouvoir compter.
Les enjeux : la ville relationnelle
— Ville interactive et collaborative
Ce qui est important dans un écosystème, comme dans tout système, c’est la néguentropie, les réseaux dormants, les signes faibles, ce qu’au fond Nicolas Bourriaud, historien de l’art et critique d’art français, appelle l’esthétique relationnelle. Avec les crises énergétiques et l’effondrement des utopies socialistes, on se tourne plutôt vers le bien vivre qui est compatible avec une croissance assez faible quantitativement. « Il faut aujourd’hui une croissance intensive de qualité, une croissance mentale, quelque chose comme une écologie de l’esprit » , citait Yann Moulier-Boutang, « … aujourd’hui les classes créatives font pression pour avoir simultanément, dans le même immeuble, loisirs, travail, communication, résidences…». Le point fondamental, c’est que nous vivons un changement de paradigme où cette recherche du bien vivre prend le pas sur l’obsession de la croissance.
La ville se compose de couches, on en compte trois. Celle du sol, avec les infrastructures matérielles, puis celle des services, la société des bureaux, et enfin l’équivalent du cloud, c’est à dire tout ce qui circulerait déjà dans nos cerveaux ou dans l’art. Ce type de connaissances se trouvent à leur tour spatialisées, temporalisées, matérialisées par la circulation.
Dans le cas qui nous occupe, faire face au défi nouveau de la ville, c’est s’appuyer sur la capacité d’innover et de créer, dont les conditions d’éclosion reposent à leur tour sur un écosystème complexe. Les urbanistes sont des agenceurs de dispositifs, des facilitateurs de l’interaction de la multitude. À l’image d’une entreprise, la Ville doit plébisciter « l’empowerment », qui consiste à mettre le citoyen au cœur du processus d’aménagement afin de libérer sa créativité. Il faut faire du citoyen un acteur du changement, que ses idées soient valorisées afin d’encourager sa prise d’initiative. Les méthodes de « living lab », qui associent les utilisateurs d’un service à son développement à partir de la première phase de conception, contribueront à cette transformation. Aujourd’hui c’est par le crowd design, le crowdfunding et le crowdsourcing que l’on trouve des solutions…
La smart-city : machine, vivante ou cyborg ?
Plusieurs métaphores antinomiques sont mobilisées pour appréhender la ville en tant que système complexe et évolutif : la machine ou bien le corps, l’artificiel ou le vivant, le technologique ou l’humain… Dans un cas, la ville serait une énorme machine, un monstre froid directement lié à l’industrialisation. On retrouve cette version dystopique et infernale dans le paysage urbain futuriste du film de science-fiction Blade Runner. Tourné en 1982, le Los Angeles de 2019 est entièrement robotisé, construit de verre et de métal, la nature et les animaux ont laissé la place aux flammes et aux nuages de pollution…
À l’opposé, une interprétation utopique serait de voir la ville comme un organisme vivant, voire un être humain pour attester de son potentiel et de sa capacité d’innovation. Empiriquement, la cité est vivante car elle est un système réticulaire[1], faite de flux, voies, artères, conduits, tuyaux, carrefours… On parle d’artères de la ville, on compare le centre au « cœur » de la ville, les « poumons » sont les espaces verts… On retrouve aussi cet aspect en littérature : dans Le Ventre de Paris, Émile Zola compare les halles centrales de Paris construites sous le Second Empire à son estomac. Cette métaphore classique de la ville comme être vivant renvoie aussi à son évolution permanente en fonction des événements historiques, sociaux, politiques ou culturels. La ville vit, est affectée et évolue au gré de ses retournements.
Tous les réseaux techniques, économiques, sociaux ou culturels sont essentiels à la vitalité de la ville. Si les réseaux techniques s’arrêtent, la ville s’interrompt aussitôt. Cette ville en tant qu’organisme est donc exposée à la mort par asphyxie technique, surpopulation ou pollution démesurée. La dépendance de la ville pour les technologies nous pose cependant la question de son importance dans les transformations urbaines à venir. La dimension techno-centrée de la Smart City inquiète par sa capacité à standardiser et contrôler les espaces, en engendrant ainsi des villes stériles et délaissées. Se rapproche-t-elle de l’image d’une ville vivante ou bien de ville machine ?
La place de l’humain
Au-delà de la Smart City, entretien avec Carlos Moreno
Carlos Moreno, chercheur en systèmes complexes, robotique et intelligence artificielle s’intéresse à la construction urbaine à travers l’humain, ses interactions et ses besoins. La tendance à penser la ville uniquement dans sa dimension technologique, à travers les infrastructures et interactions numériques ne permet pas d’assurer une bonne qualité de vie aux citadins.
L’auteur met en avant l’humanité de la ville au-delà de son aspect technologique. La ville vivante est celle où les individus communiquent et interagissent avec leur environnement socio- territorial-urbain. Les grands projets des premières Smart Cities comme Songdo ou Masdar ont trop ignoré la place de l’humain et sont dès lors désertées par la population.
— L’humain doit se réapproprier la ville
S’il ne faut pas dénigrer l’importance centrale des outils numériques dans la conception et l’évolution des villes de demain, penser la technologie comme une solution à tous les problèmes ne fera qu’engendrer des « villes mortes ». La ville vivante doit s’attacher à comprendre les rapports entre les citadins et la manière dont ils interagissent avec leur environnement. Les villes de Medelliin et de Détroit sont des exemples formidables de résilience et de réinvention. La société civile s’est impliquée dans l’identification des maux de son territoire et sa renaissance. La réappropriation de la ville par les citoyens est essentielle.
”« La ville vivante est un écosystème créatif dans lequel citoyens et gouvernance peuvent échanger de manière transverse, où la manière de construire n’est plus dictée par une verticalité de la technologie ou de l’architecture. »
Carlos Moreno

La ville cyborg de PICON
Antoine Picon, qui enseigne l’histoire de l’architecture et des techniques à l’Université Harvard, nomme la ville intelligente la ville cyborg pour traduire son couplage entre l’homme et la machine. Il considère le terme « intelligent » dans son sens habituel, c’est-à-dire comme une capacité à apprendre, comprendre et raisonner. À travers son analyse de la Smart City, il montre que ce concept n’est pas réductible aux nouvelles technologies disponibles pour la gestion de l’espace urbain. C’est plutôt l’émergence d’un être composite qui a pour but de créer un lien entre l’homme et la cité.
Au niveau des transports, la ville intelligente offre aux citadins un ensemble de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de leurs besoins. Elle peut répondre de manière adaptée à la demande en temps réel. Elle peut également informer ou encore alarmer. Elle serait un être doté de sentiments.
Il est facile de se projeter : notre rétine muée en écran d’ordinateur, des flux d’informations en temps réel nous indiquant où trouver du premier coup la réponse à notre besoin. Ces protocoles de communication et ces algorithmes de recherche sont nos membres artificiels greffés. Cependant, au sein de l’hybridation de l’homme et la machine, c’est la composante humaine qui se doit d’assurer les prises de décision ainsi que les fonctions liées à la conscience.
— Fracture numérique
« À partir du moment où la ville apparaît, on constate de la différenciation et, forcément, des inégalités », Antoine Picon insiste aussi sur la nécessité d’opérer des choix politiques pour éviter que le numérique accroisse les inégalités en ville.
En effet, dans la mesure où la ville intelligente s’actionne autour de la technologie, cela implique que l’ensemble des acteurs, mais surtout, les habitants auxquels la ville s’adresse, maitrisent cette technologie. Tout le monde devra savoir utiliser un matériel spécifique, et d’autre part la capacité à aller chercher adéquatement l’information. En termes d’accès à la technologie ou de compétences pour exploiter ladite technologie, ces deux éléments constituent des facteurs d’inégalités entre groupes sociaux, qu’il convient de ne pas négliger.
La ville « trop intelligente » de Richard Sennett
« Personne ne veut d’une ville trop intelligente ». L’auteur écrit ce texte préalablement à la conférence sur les villes intelligentes qui s’est déroulée à Londres en décembre 2012. L’enjeu de l’article consiste à promouvoir une vision de la Smart City qui utilise à bon escient les technologies de pointe, afin d’affecter positivement le mode de vie des citadins.
Les Smart cities sont déjà utilisées comme modèles de développement urbain en Chine ou en Europe. Avec la révolution numérique, la ville va être totalement maîtrisée par l’intelligence informatique. Les progrès technologiques peuvent affecter la ville et nos modes de vie de manière radicalement différente : s’ils peuvent être un outil de communication et de collaboration, ils sont aussi utilisés pour brider et contrôler une ville qui deviendrait stérile. À ce titre, l’auteur donne l’exemple de deux projets de villes technologiques : Masdar aux Émirats arabes unis et Songdo en Corée du Sud.
— Masdar, à la recherche de l’efficacité
Masdar est une ville à moitié construite dans le désert. La maîtrise d’œuvre de la ville a été entièrement attitrée à l’agence de Norman Foster. La ville a été pensée selon des principes « fordistes » : pour chaque activité ont été définis un lieu et une temporalité appropriée. La ville étant planifiée dans un but d’efficacité maximale, les citadins ont des choix préétablis pour toutes leurs commodités.
Le « zonage excessif » de la ville rendrait alors impossible la possibilité de nouvelles activités dont on ignore encore le contenu et l’endroit où elles vont se développer. De plus, dans une logique d’intelligence collective et citoyenne, laisser à ses citoyens le droit d’expérimenter, de diversifier les usages, de se tromper permet de fabriquer une ville qui puisse se réinventer. Cette démarche est logiquement irréalisable dans ce type de villes totalement rationalisées.

— Songdo, ville anonyme
À Songdo, l’absence de diversité au sein des blocs massifs et utilitaires rend l’ensemble inorganique et morne. L’architecture uniforme ne signifie pas toujours que l’environnement est sans vie : la Troisième Avenue de New York a par exemple été divisée en plusieurs commerces et cafés de styles et tailles variés. Cependant, l’uniformité du tissu urbain de la Smart City coréenne rend impossible les expériences de sérendipité pour le citadin. L’espace urbain est donc prévisible et monotone ; il n’y a rien à découvrir dans les rues.
Dans ces nouvelles « villes intelligentes », les bâtiments anonymes qui s’enchainent ne permettent pas de créer un sentiment d’appartenance et des expériences de sérendipité. Le sentiment de vivre ennuyeuse et sans âme est largement motivée par les intérêts financiers de grandes firmes technologiques. La place de l’humain et de ses usages a été oubliée au profit de son aspiration à devenir un modèle de ville durable à la pointe de la technologie.
Dans tel cas, quelle place peut-on laisser à l’imprévu et aux usages alternatifs de la ville ? L’auteur explique : « Tout le monde préfère vivre dans une ville plus ouverte et moins déterminée, dans laquelle il est possible de se faire une place, car c’est ainsi que l’on prend possession de sa propre vie. »

”« La valeur des villes se mesure au nombre de lieux qu’elles réservent à l’improvisation. »
Siegfried Kracauer, Rues de Berlin et d’ailleurs, 2013
Enjeux financiers
Les données pour mieux consommer
Des tentatives plus judicieuses de formation d’une ville intelligente ont été pensées aux quatre coins du monde. À Rio de Janeiro, pour faire face aux inondations fréquentes et dévastatrices, les nouvelles technologies de l’information ont été appliquées pour prévoir ces catastrophes naturelles. Le maire s’est tourné vers IBM et son Deep thunder, un système couplant algorithmique et calcul intensif. « Nous avons mobilisé du personnel d’IBM research pour développer des modèles de simulation, explique Philippe Sajhau, le vice-président chargé des Smarter Cities chez IBM France. Et nous avons travaillé avec la collectivité, les services météo et des associations. » Cela a débouché sur une ville maillée en carrés d’un kilomètre de côté. La corrélation de ces différentes sources d’informations permet d’anticiper les risques naturels avec 48 heures d’avance et de s’organiser plus efficacement.
Cette analyse des données, permet de tout contrôler : le taux d’émission global de CO2 sur le territoire par exemple. Santander est depuis 2010 l’une des villes pionnières à ce sujet. Ce sont 20 000 capteurs qui sont installés sur une étendue de 40 km2. Tout est passé au crible : le remplissage des poubelles, le trafic, le degré d’humidité… Les informations et rues connectées permettent à la ville d’économiser 40% de la consommation des lampadaires en ajustant par exemple l’intensité selon la présence de passants à un moment précis.
Toutefois, cette expérience montre le pouvoir d’ubiquité dont peut disposer la ville intelligente. À l’instar de Rio, le boulevard connecté de Nice[1] est un bon terrain d’observation de la collecte et l’exploitation d’un grand nombre de données sur les individus. C’est un nombre incalculable de puces équipées pour mesurer et traiter des données, des mesures, des transactions… Autre exemple, les 120 000 arbres de Paris sont équipés d’une puce de radio-authentification. Cela donne un accès aux techniciens des parcs et jardins, à tout l’historique d’interventions auprès de l’arbre.
Si ce type d’initiative vante les mérites d’une ville « harmonieuse », fluide et interconnectée, elle appelle à être critique sur les conséquences que peuvent présenter ces dispositifs intelligents sur les individus et la société urbaine.

Des Smart Cities de l’ubiquité
On se retrouve alors en pleine ubiquité des technologies de l’information et de la communication (T.I.C.), c’est-à-dire, la capacité pour ces technologies d’être accessibles à tout moment et en tout lieu. Or, l’avènement d’une ville totalitaire, entièrement sous contrôle numérique à l’image du 1984 de George Orwell hante depuis longtemps l’imagination des romanciers et des réalisateurs de science-fiction.
La Smart City apparaît désormais comme un vaste système d’information capable de mesurer et d’enregistrer toutes les activités humaines en temps réel. L’application du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, impose une certaine réflexion quant à l’utilisation de ces données. Dans le cas d’une collectivité, il est nécessaire de faire preuve d’une transparence totale sur la récolte et l’exploitation de ces dernières, au risque d’une perte de confiance de la part des usagers envers le service public.
À travers le récit de son expérience de voyage à Songdo, le consultant et fondateur de l’agence Quartier Libre, Julien Eymeri, fait un constat sur l’idée de ville intelligente. Ses technologies sont essentiellement sécuritaires et en font une zone où tout semble fonctionnel et processé[1]. Une zone où sont enregistrés les moindres faits et gestes des habitants, et où les puissants algorithmes optimisent l’activité des infrastructures dans une volonté d’efficience absolue. Une efficacité et une durabilité pour des villes qui ressemblent à des opportunités de marchés juteux pour de nombreuses structures mondiales.
— U-city
La « U-City » ou « Ubiquitous City » est le terme utilisé pour désigner le terrain d’expérimentation des grandes entreprises technologiques. Alphabet, le holding de Google, a annoncé en octobre 2017 avoir signé un contrat avec la ville de Toronto pour la création d’un quartier « made in internet ». Sidewalk Labs, filiale d’Alphabet, va réaliser un investissement de 50 millions de dollars pour plus de 300 hectares. Sur l’ensemble de cette superficie la technologie est infiltrée à l’intérieur même du bâti via des synapses informatiques enterrées ou emmurées. Des milliers de caméras de surveillance filment l’intégralité de l’activité urbaine en temps réel, des traceurs des véhicules enregistrent systématiquement les déplacements de ses habitants. Toutes ces données sont exploitées par des algorithmes.
C’est le deuxième coup d’éclat d’Alphabet après la diffusion d’une liste de seize villes américaines avec qui elle va travailler sur les sujets des véhicules autonomes, de la mobilité partagée et la gestion des données de la ville. Une aubaine pour Google d’acquérir de précieuses données pour prendre une avance considérable sur ses concurrents en matière de Smart City.
Cela marque une évolution stratégique. Il ne s’agit plus de construire des villes spectaculaires telles que Songbo en Corée du Sud, mais de mener des projets expérimentaux en lien avec les autorités locales et la population.

Un pas vers une ère biopolitique
Le nouveau modèle utopique, réalisé à des fins financières et marketing, nous rappelle l’émergence et le succès fulgurant de la vidéosurveillance en France à partir de l’élection présidentielle de 2007. Dans son ouvrage Vidéosurveillance : le bluff technologique, le sociologue Laurent Mucchielli montre avec ses enquêtes l’impact très limité de la vidéosurveillance sur l’insécurité. Désormais devenu un argument de marketing territorial essentiel pour les élus, les dépenses publiques colossales pour la vidéosurveillance sont un « bluff technologique ». Les enquêtes prouvent que le système sert bien plus à réprimer les petites infractions routières que les agressions ou les vols.
Ainsi, la collecte de données massives (big data) et les technologies de pointe ne sont pas au service des populations, mais tendent au contraire à faire de l’espace public une zone de pouvoir et de surveillance. Cette analyse nous ramène aux travaux de M. Foucault sur le bio-pouvoir.
Il étudie les technologies de pouvoir et, souligne qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la vie de l’espèce humaine devient l’enjeu des stratégies politiques. Il apparaît alors de nouvelles techniques de pouvoir, des mécanismes qui encadrent et assurent un contrôle constant.
Le crowdsourcing urbain, activant les capacités informationnelles des smartphones équipés de leurs usagers, est un moyen de collecter une information localisable et localisée, 24 heures sur 24, avec une efficacité optimale. Chaque citadin et chaque passant est alors transformé en capteur. Cela permet de mettre en place le concept du « Nudge ». Des suggestions indirectes peuvent, sans forcer, influencer les motivations, et la prise de décision des groupes et des individus.
Conclusion
Nous sommes en droit de nous questionner sur l’apport de l’intelligence humaine et collective face à toute cette réflexion algorithmique. L’« hyper-numérisation » de la gestion urbaine laisse finalement peu de place au citoyen, au profit du recueil des données. Les velléités d’une ville intelligente à tout prix ne seraient-elles pas dûes à des raisons économiques et de contrôle des populations ? L’alliance des « Sharing cities » (42 métropoles) unies contre les « impacts négatifs » de l’économie de plateformes se présente comme une opposition à l’hyper-numérisation des villes.
Il faut laisser aux villes la possibilité de se construire de manière spontanée : à l’écoute de ses habitants et non pas sous son contrôle permanent. Ainsi, les innovations technologiques et numériques ne doivent pas faire de la ville un espace mécanique et contrôlé.
C’est l’usage de l’espace public qui créee de la valeur. Il est essentiel d’évaluer de manière critique les conséquences que les dispositifs d’intelligence artificielle présentent sur les individus, leurs interactions et leurs usages de l’espace public. Or, la permissivité dans l’espace public est essentielle à la densité de ses usages. Ces innovations vont être détournées par les usages de la ville dans une diversité de configurations urbaines, sociales et culturelles. La technologie doit être utilisée pour développer la collaboration, la mise en réseau des acteurs de la ville. La seule acception de ville intelligente n’est donc pas suffisante : elle est aussi sensible, durable, récréative, malléable…
Concilier cette intelligence collective avec l’intelligence artificielle.
- Smart Cities – Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur – Antoine Picon
- La vidéosurveillance est un gaspillage de l’argent public – Hervé Jouanneau – La Gazette des communes
- A Barcelone, des initiatives ouvertes et collaboratives pour résister à l’ubérisation des villes – Claire Legros – Le Monde
- Penser la ville intelligente telle qu’elle est, la réguler telle qu’elle pourrait être – François Ménard – Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
- Au-delà de la smart city – Carlos Moreno – PCA-Stream
- Et si la vidéosurveillance était complètement inefficace ? – Paul Tommasi et Nonfiction – Slate
- Le temps du cyborg dans la ville territoire – Antoine Picon
- LA VILLE INTELLIGENTE Origine, définitions, forces et limites d’une expression polysémique – Sandra Breux et Jérémy Diaz – INRS
- Smart city : dis, c’est quoi une ville intelligente ? – Alan – ConsoGlobe
- Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives – Vito Albino, Umberto Berardi and Rosa Maria Dangelico
- Une « ville intelligente » doit contenir les inégalités « dans des limites raisonnables » – Francis Pisani – Le Monde
- Vers une biopolitique des villes. La pensée contemporaine des villes productives – Raphaël Besson